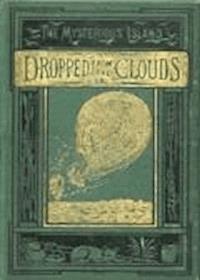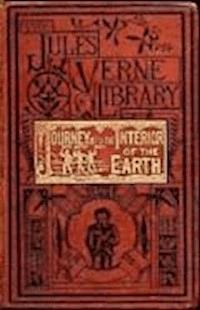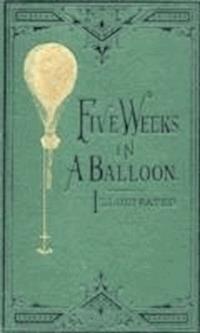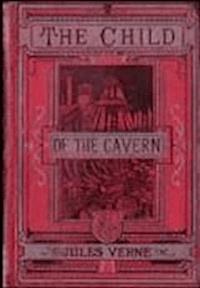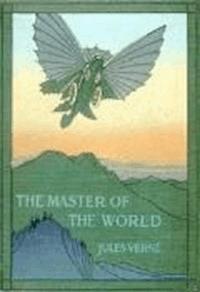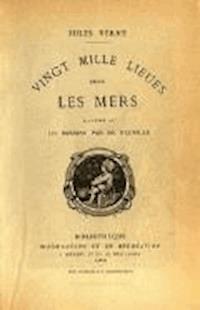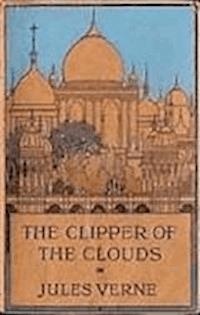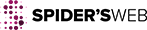14,90 zł
Dowiedz się więcej.
- Wydawca: KtoCzyta.pl
- Kategoria: Powieści przygodowe i historyczne
- Język: polski
«Un drame en Livonie» est un roman de Jules Verne dont le thème principal est la confrontation de deux partis au conseil municipal de Riga: le parti «slave», soutenu principalement par les couches inférieures de la population – le prolétariat et la paysannerie et le «allemand», – la noblesse et la grande bourgeoisie, et la lutte sociale et politique de la population locale contre la domination des barons de l’Ostsee est liée à une intrigue criminelle.
Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:
Liczba stron: 305
Podobne
Jules Verne
Un drame en Livonie
Varsovie 2020
Table des matières
I. Frontière franchie
II. Slave pour Slave
III. Famille Nicolef
IV. En malle-poste
V. Le Rabat de la « Croix-Rompue »
VI. Slaves et Germains
VII. Descente de police
VIII. À l’université de Dorpat
IX. Dénonciation
X. Interrogatoire
XI. En face de la foule
XII. Wladimir Yanof
XIII. Deuxième perquisition
XIV. Coups sur coups
XV. Sur une tombe
XVI. Confession
I. Frontière franchie.
Cet homme était seul dans la nuit. Il passait comme un loup entre les blocs de glace entassés par les froids d’un long hiver. Son pantalon doublé, son « khalot », sorte de cafetan rugueux, en poil de vache, sa casquette à oreillettes rabattues, ne le défendaient qu’imparfaitement des atteintes de l’âpre bise. De douloureuses gerçures fendaient ses lèvres et ses mains. La pince de l’onglée lui serrait l’extrémité des doigts. Il allait à travers une obscurité profonde, sous un ciel bas dont les nuages menaçaient de se résoudre en neige, bien que l’on fût déjà aux premiers jours d’avril, mais à la haute latitude du cinquante-huitième degré.
Il s’obstinait à ne pas s’arrêter. Après une halte, peut-être eût-il été incapable de reprendre sa marche.
Vers onze heures du soir, cet homme s’arrêta cependant. Ce ne fut pas parce que ses jambes lui refusaient le service, ni parce que le souffle lui manquait, ni parce qu’il succombait à la fatigue. Son énergie physique valait son énergie morale. Et, d’une voix forte, avec un inexprimable accent de patriotisme :
« Enfin... la frontière... s’écria-t-il, la frontière livonienne... la frontière du pays ! »
Et de quel large geste il embrassa l’espace qui s’étendait devant lui à l’ouest ! De quel pied assuré il frappa la surface blanche du sol comme pour y graver son empreinte au terme de cette dernière étape !
C’est qu’il venait de loin, de très loin – des milliers de verstes, entre tant de dangers bravés par son courage, surmontés par son intelligence, vaincus par sa vigueur, son endurance à toute épreuve.
Depuis deux mois en fuite, il se dirigeait ainsi vers le couchant, franchissant d’interminables steppes, se condamnant à de pénibles détours, afin d’éviter les postes de cosaques, traversant les rudes et sinueux défilés des hautes montagnes, s’aventurant jusqu’à ces provinces centrales de l’Empire russe où la police exerce une si minutieuse surveillance ! Enfin, après avoir, par miracle, échappé aux rencontres où il eût peut-être laissé sa vie, il venait de s’écrier :
« La frontière livonienne... la frontière ! »
Était-ce donc là le pays hospitalier, celui où l’absent revient après de longues années, n’ayant plus rien à craindre, la terre natale où la sécurité lui est assurée, où des amis l’attendent, où la famille va lui ouvrir ses bras, où une femme, des enfants, guettent son arrivée, à moins qu’il ne se soit fait une joie de les surprendre par son retour ?...
Non ! Ce pays, il ne ferait qu’y passer, en fugitif. Il essayerait de gagner le port de mer le plus rapproché. Il tâcherait de s’embarquer sans éveiller les soupçons. Il ne serait en sûreté que lorsque le littoral livonien aurait disparu derrière l’horizon.
« La frontière ! » avait dit cet homme. Mais quelle était cette frontière, dont aucun cours d’eau ne fixait la limite, ni la saillie d’une chaîne, ni les massifs d’une forêt ?... N’existait-il là qu’un tracé conventionnel, sans aucune détermination géographique ?...
En effet, c’était la frontière qui sépare de l’Empire russe ces trois gouvernements de l’Esthonie, de la Livonie, de la Courlande, compris sous la dénomination de provinces Baltiques. Et, en cet endroit, cette ligne limitrophe partage du sud au nord la surface, solide l’hiver, liquide l’été, du lac Peipous.
Qui était ce fugitif, âgé de trente-quatre ans environ, haut de taille, d’une structure vigoureuse, épaules larges, torse puissant, membres solides, d’allure très déterminée ? De son capuchon, rabattu sur sa tête, s’échappait une barbe blonde, bien fournie, et, lorsque la brise le soulevait, on aurait vu briller deux yeux vifs, dont le vent glacé n’éteignait pas le regard. Une ceinture à larges plis lui ceignait les reins, dissimulant une mince sacoche de cuir, qui contenait tout son argent, réduit à quelques roubles-papier, et dont le montant ne pouvait plus fournir aux exigences d’un voyage de quelque durée. Son fourniment de route se complétait d’un revolver à six coups, d’un couteau serré dans sa gaine de cuir, d’une musette contenant encore un reste de provisions, d’une gourde à demi pleine de schnaps, et d’un solide bâton. Musette, gourde et même sacoche, c’étaient, dans sa pensée, des objets moins précieux que ses armes, dont il était décidé à faire usage en cas d’attaque de fauves ou d’agents de la police.
Aussi ne voyageait-il que de nuit, avec la préoccupation constante d’atteindre, inaperçu, l’un des ports de la mer Baltique ou du golfe de Finlande.
Jusqu’alors, pendant un si dangereux cheminement, il avait pu passer, bien qu’il ne fût point nanti de ce « porodojna », délivré par l’autorité militaire, et dont la présentation doit être réclamée par les maîtres de poste de l’Empire moscovite. Mais en serait-il ainsi aux approches du littoral, où la surveillance est plus sévère ?... Il n’était pas douteux que sa fuite eût été signalée, qu’appartenant à la catégorie des criminels de droit commun ou à celle des condamnés politiques, il dût être recherché avec le même soin, poursuivi avec le même acharnement. En vérité, si la fortune, jusqu’ici favorable, l’abandonnait à la frontière livonienne, ce serait échouer au port.
Le lac Peipous, long de cent vingt verstes environ, large de soixante, est fréquenté, pendant la saison chaude, par des pêcheurs qui exploitent ses eaux poissonneuses. La navigation s’y effectue au moyen de ces lourdes barques, rudimentaire assemblage de troncs d’arbres à peine équarris et de planches mal rabotées, nommées « struzzes », qui transportent, par les déversoirs naturels du lac, aux bourgades voisines et jusqu’au golfe de Riga des chargements de blé, de lin, de chanvre. Or, à cette époque de l’année, et sous cette latitude des printemps tardifs, le lac Peipous n’est pas praticable aux embarcations, et un convoi d’artillerie pourrait traverser sa surface durcie par les froids d’un rigoureux hiver. Ce n’était encore qu’une vaste plaine blanche, hérissée de blocs à sa partie centrale, embarrassée d’énormes embâcles à la naissance des fleuves.
Tel était l’effrayant désert que le fugitif franchissait d’un pied sûr, s’orientant sans peine. D’ailleurs il connaissait la région et marchait d’un pas rapide qui lui permettrait d’atteindre la rive occidentale avant le lever du jour.
« Il n’est que deux heures après minuit, se dit-il alors. Plus qu’une vingtaine de verstes à faire, et, là-bas, je ne serai pas gêné de trouver quelque hutte de pêcheur, une hutte abandonnée, où je me reposerai jusqu’au soir... Maintenant, je ne vais plus au hasard en ce pays ! »
Et il semblait qu’il oubliât ses fatigues, qu’il sentît la confiance lui revenir. Si la malchance voulait que les agents reprissent la piste qu’ils avaient perdue, il saurait leur échapper.
Le fugitif, craignant d’être trahi par les premières lueurs de l’aube avant d’avoir traversé le lac Peipous, s’imposa un dernier effort.
Réconforté d’une bonne gorgée de schnaps qu’il puisa à sa gourde, il se lança dans une marche plus rapide, sans se permettre aucune halte. Aussi, vers quatre heures du matin, quelques maigres arbres, des pins blancs de givre, des bouquets de bouleaux et d’érables, lui apparurent-ils confusément à l’horizon.
Là était la terre ferme. Là, aussi, les périls seraient plus grands.
Si la frontière livonienne coupe le lac Peipous en sa partie médiane, ce n’est pas sur cette ligne, on le comprend, que sont établis les postes de douaniers. L’administration les a reportés à cette rive occidentale que les struzzes accostent pendant la saison d’été.
Le fugitif ne l’ignorait pas, et il ne put être étonné de voir une lumière briller vaguement, qui faisait comme une trouée jaunâtre au rideau des brumes.
« Ce feu bouge-t-il ou ne bouge-t-il pas ?... » se demanda-t-il, en s’arrêtant près de l’un des blocs de glace qui se dressaient autour de lui.
Si le feu se déplaçait, c’est que c’était celui d’un falot porté à la main, probablement pour éclairer une ronde de douaniers en marche de nuit sur cette partie du Peipous, et il importait de ne point se trouver sur son passage.
Si ce feu ne se déplaçait pas, c’est qu’il éclairait l’intérieur de l’un des postes de la rive, car, à cette époque, les pêcheurs n’ont point encore réintégré leurs cabanes, attendant la débâcle qui ne commence guère avant la seconde quinzaine d’avril. La prudence conseillait donc de prendre direction à droite ou à gauche, afin de ne point se montrer en vue dudit poste.
Le fugitif obliqua vers la gauche. De ce côté, autant qu’on en pouvait juger à travers la brume qui se levait au souffle de la brise du matin, les arbres paraissaient plus serrés. En cas de poursuite, peut-être rencontrerait-il là d’abord quelque refuge, ensuite quelque facilité pour fuir.
L’homme avait fait une cinquantaine de pas lorsqu’un sonore « qui vive ? » éclata sur sa droite.
Ce « qui vive ? » prononcé avec un fort accent germanique, qui ressemblait au « verda » allemand, produisit la plus désagréable impression sur celui auquel il s’adressait. D’ailleurs, la langue allemande est la plus employée, sinon par les paysans, du moins par les citadins des provinces Baltiques.
Le fugitif ne répondit point au « qui vive ? » Il se jeta à plat ventre sur la glace et fit bien. Une détonation retentit presque aussitôt, et, sans cette précaution, une balle l’eût frappé en pleine poitrine. Mais échapperait-il à la ronde des douaniers ?... Ceux-ci l’avaient aperçu, nul doute à cet égard... Le cri et le coup de feu en témoignaient... Cependant, au milieu de cette obscurité brumeuse, ils pouvaient se croire dupes d’une illusion... Et, en effet, le fugitif eut tout lieu de l’admettre, d’après les propos qui furent échangés entre ces hommes, lorsqu’ils s’approchèrent.
Ils appartenaient à l’un des postes du lac Peipous, pauvres diables à l’uniforme passé du verdâtre au jaunâtre, et qui tendent si aisément la main aux pourboires, tant sont maigres les traitements que leur paye la « tamojna », la douane moscovite. Ils étaient deux, qui revenaient vers leur poste, lorsqu’ils avaient cru entrevoir une ombre entre les blocs.
« Tu es sûr d’avoir aperçu ?... disait l’un.
– Oui, répondait l’autre, quelque contrebandier qui essayait de s’introduire en Livonie...
– Ce n’est pas le premier de cet hiver, ce ne sera pas le dernier, et j’imagine que celui-là court encore, puisque nous n’en trouvons plus trace !
– Eh ! répliqua celui qui avait tiré, on ne peut guère viser au milieu d’une brume pareille, et je regrette de n’avoir pas mis notre homme à terre... Un contrebandier a toujours sa gourde pleine... Nous aurions partagé en bons camarades...
– Et il n’y a rien de tel pour vous refaire l’estomac ! » ajouta l’autre !
Les douaniers continuèrent leurs recherches, plus affriolés, sans doute, à la pensée de se réchauffer d’une large lampée de schnaps ou de vodka qu’à celle d’opérer la capture d’un fraudeur. Ce fut peine inutile.
Dès que le fugitif les crut suffisamment éloignés, il reprit sa marche en se dirigeant vers la rive, et avant le lever du jour, il avait trouvé un abri sous le paillis d’une hutte déserte, à trois verstes dans le sud du poste.
Sans doute, la prudence aurait exigé qu’il veillât pendant cette journée, qu’il se tînt en observation, afin d’être en garde contre toute approche suspecte, qu’il fût à même de s’échapper, si les douaniers poussaient leurs recherches du côté de la hutte. Mais, rompu de fatigue, cet homme, si endurant qu’il fût, ne put résister au sommeil.
Étendu dans un coin, enveloppé de son cafetan, il s’endormit profondément, et la journée était avancée déjà lorsqu’il vint à se réveiller.
Il était alors trois heures de l’après-midi. Par bonheur, les douaniers n’avaient point quitté leur poste, s’en tenant à leur unique coup de fusil de la nuit, et très disposés à admettre qu’ils avaient fait erreur. Le fugitif ne pouvait que se féliciter d’avoir échappé à ce premier danger, au moment où il franchissait la frontière de son pays.
À peine réveillé, le besoin de dormir satisfait, il dut pourvoir au besoin de manger. Les quelques provisions que contenait sa musette suffiraient à lui assurer un repas ou deux. Mais il serait indispensable de les renouveler à la prochaine halte, ainsi que le schnaps de sa gourde, dont il épuisa les dernières gouttes.
« Des paysans ne m’ont jamais repoussé, se dit-il, et ceux de Livonie ne repousseront pas un Slave comme eux ! »
Il avait raison, mais il ne fallait pas que la mauvaise fortune le conduisît chez quelque cabaretier d’origine germanique, comme il en est dans ces provinces. Ceux-là ne feraient point à un Russe l’accueil que celui-ci avait trouvé chez les paysans de l’Empire moscovite.
Au surplus, le fugitif n’en était pas à implorer la charité sur sa route. Il lui restait encore un certain nombre de roubles qui lui permettraient de subvenir à ses besoins jusqu’au terme du voyage, en Livonie du moins. Il est vrai, pour s’embarquer, comment ferait-il ?... Il aviserait plus tard. L’important,
l’essentiel, c’était d’atteindre, sans se laisser prendre, l’un des ports du littoral, sur le golfe de Finlande ou sur la mer Baltique, et c’est à ce but que devaient tendre tous ses efforts.
Dès que l’obscurité lui parut suffisante, – vers sept heures du soir, – ayant mis son revolver en état, le fugitif quitta la hutte. Le vent avait halé le sud pendant la journée. La température s’était relevée au zéro centigrade, et la couche de neige, piquée de points noirâtres, indiquait une tendance à fondre.
Toujours même aspect du pays. Peu élevé dans sa partie centrale, il ne présente de tumescences de quelque importance que dans le nord-ouest, et leur altitude ne dépasse pas de cent à cent cinquante mètres. Ces longues plaines n’offrent aucune difficulté au cheminement d’un piéton, à moins que le dégel ne rende le sol momentanément impraticable, et peut-être y avait-il lieu de le craindre.
Donc, il importait de gagner le port, et, si la débâcle arrivait prématurément, ce serait tant mieux, puisque la navigation redeviendrait possible.
Quinze verstes environ séparent le Peipous de la bourgade d’Ecks, que le fugitif atteignit dès six heures du matin ; mais il prit garde de l’éviter. C’eût été s’exposer, de la part des agents de la police, à une demande de papiers qui eût été très embarrassante. Ce n’était pas à cette bourgade qu’il convenait de chercher refuge. Cette journée, il la passa, à une verste, dans une masure abandonnée, d’où il repartit à six heures du soir, en inclinant vers le sud-ouest, dans la direction de la rivière d’Embach, qu’il rencontra après une étape de onze verstes, – rivière qui mêle ses eaux à celles du lac Watzjero à sa pointe septentrionale.
En cet endroit, au lieu de prendre à travers les bois d’aulnes et d’érables massés sur les rives, le fugitif trouva plus prudent de cheminer sur le lac, dont la solidité n’était pas encore compromise.
Une assez grosse pluie, provenant de nuages élevés, tombait alors et activait la dissolution de la couche de neige. Les symptômes d’un prochain dégel se manifestaient sérieusement. Le jour n’était pas éloigné où se produirait la dislocation des glaces à la surface des cours d’eau de la région.
Le fugitif marchait d’un pas rapide, désireux d’atteindre la pointe du lac avant le retour de l’aube. Vingt-cinq verstes à enlever, rude étape pour un homme déjà fatigué, et la plus longue qu’il se fût encore imposée, puisqu’elle aurait été, cette nuit-là, d’une cinquantaine de verstes – soit une douzaine de lieues métriques.
Les dix heures de repos de la journée suivante auraient été bien gagnées.
C’était, au total, une regrettable circonstance que le temps se fût mis à la pluie. Un froid sec eût rendu la marche plus aisée et plus rapide. Il est vrai, sur cette glace unie de l’Embach, le pied trouvait un point d’appui que ne lui eût pas offert le chemin des berges, déjà tout empli de la boue du dégel. Mais des craquements sourds, quelques fissures, indiquaient une dislocation prochaine et une débâcle des glaçons. De là, autre difficulté pour un piéton, s’il avait une rivière à traverser, à moins qu’il ne le fît à la nage. Pour toutes ces raisons il fallait, au besoin, doubler les étapes.
Il le savait bien, cet homme, et il déployait une énergie surhumaine. Son cafetan, étroitement serré, le garantissait des rafales. Ses bottes en bon état, car il les avait récemment renouvelées, renforcées de gros clous à la semelle, assuraient son pas sur ce sol glissant. Et puis, dans cette obscurité profonde, il n’avait point à s’orienter, puisque l’Embach le conduisait directement à son but.
À trois heures du matin, vingt verstes avaient été enlevées. Pendant les deux heures qui précéderaient l’aube, le lieu de halte serait atteint. Cette fois encore, nulle nécessité de se risquer en quelque village, de chercher abri en quelque auberge, puisque les provisions suffiraient pour une journée. N’importe quel refuge, pourvu que la sécurité y fût assurée jusqu’au soir. Sous ces bois qui enveloppent la pointe septentrionale du Watzjero, on trouve des cabanes de bûcherons inhabitées durant l’hiver. Avec le peu de charbon qu’elles renferment, avec le bois mort tombé des arbres, il est facile de se procurer une bonne flambée qui réchauffe, on peut le dire, le corps et l’âme, et il n’est pas à craindre que la fumée d’un foyer trahisse au sein de ces vastes solitudes.
Certes, cet hiver avait été dur ; mais, sa rigueur à part, combien il avait favorisé la fuite du fugitif depuis son arrivée sur le sol de l’Empire !
Et, d’ailleurs, l’hiver n’est-il pas l’ami des Russes ? selon le dicton slave, et ne sont-ils pas assurés de sa rude amitié ?...
À cet instant, un hurlement se fit entendre du côté de la berge gauche de l’Embach. Il n’y avait pas à s’y tromper, c’était le hurlement d’un fauve à quelques centaines de pas. L’animal s’approchait-il ou s’éloignait-il ?... L’obscurité ne permettait pas de le reconnaître.
L’homme s’arrêta un instant, prêtant l’oreille. Il lui importait de se tenir sur ses gardes, de ne pas se laisser surprendre.
Le hurlement se reproduisit à plusieurs reprises, plus intense. D’autres lui répondirent.
Nul doute, une bande de fauves remontait la rive de l’Embach, et il était possible qu’ils eussent senti la présence d’une créature humaine.
Or, voici que ce lugubre concert éclata avec une telle violence que le fugitif se crut sur le point d’être attaqué.
« Ce sont des loups, se répétait-il, et, maintenant, la bande n’est pas loin. »
Le danger était extrême. Affamés à la suite d’un rigoureux hiver, ces fauves sont redoutables. Un loup seul, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, à la condition d’être vigoureux et de sang-froid, n’eût-on qu’un bâton à la main. Mais une demi-douzaine de ces animaux, il est difficile de les repousser, eût-on un revolver à sa ceinture, à moins que tous les coups ne portent.
Trouver un endroit où se mettre pour éviter l’agression, il n’y fallait pas songer. Les rives de l’Embach étaient basses et dénudées. Pas un arbre dont on aurait pu escalader les branches. La bande ne devait pas être à cinquante pas, soit qu’elle se fût lancée sur la glace, soit qu’elle bondît à travers le steppe. Il n’y avait d’autre parti à prendre que de fuir à toutes jambes, sans grand espoir de distancer ces carnassiers, quitte à s’arrêter, à se retourner pour faire face à leur attaque. C’est ce que fit l’homme, mais bientôt il sentit les fauves sur ses talons. Des rugissements éclatèrent à moins de vingt pas derrière lui. Il s’arrêta, et il lui sembla que l’ombre était illuminée de points brillants, de braises ardentes.
C’étaient les yeux des loups, – de ces loups amaigris, efflanqués, rendus féroces par un long jeûne, avides de cette proie qu’ils sentaient à la portée de leurs dents.
Le fugitif se retourna, son revolver d’une main, son bâton de l’autre. Mieux valait ne pas faire feu si le bâton pouvait suffire, et, en cas que quelques agents rôdassent dans le voisinage, ne pas attirer leur attention.
L’homme s’était solidement campé, après avoir dégagé ses bras des plis du cafetan. Un rapide moulinet arrêta d’abord ceux des loups qui le serraient de près. Et, l’un d’eux lui ayant sauté à la gorge, un coup de bâton retendit sur le sol.
Mais, au nombre d’une demi-douzaine, ils étaient trop pour prendre peur, trop pour qu’il fût possible de les exterminer les uns après les autres sans faire usage du revolver. D’ailleurs, après un second coup assené sur la tête d’un second fauve, le bâton se brisa dans la main qui le maniait si terriblement.
L’homme se remit en fuite, et, les loups s’étant lancés sur ses pas, s’arrêtant de nouveau il fit feu quatre fois.
Deux bêtes, mortellement blessées, tombèrent sur la glace teinte de leur sang ; mais les dernières balles se perdirent, les deux autres loups s’étant écartés d’un bond à vingt pas.
Le fugitif n’avait pas le temps de recharger son revolver. La bande revenait déjà et se fût précipitée sur lui. Au bout de deux cents pas, les fauves étaient sur ses talons, mordant les basques de son cafetan, dont les morceaux déchirés leur restaient dans la gueule. Il sentait leur haleine brûlante. S’il faisait un faux pas, c’était fait de lui. Il ne se relèverait plus, il serait déchiré par les bêtes furieuses.
Sa dernière heure était-elle donc arrivée ?... Tant d’épreuves, tant de fatigues, tant de dangers pour rentrer sur le sol natal, et ne pas même y laisser quelques ossements !
Enfin, l’extrémité du lac apparut avec les premières lueurs de l’aube. La pluie avait cessé, toute la campagne était enveloppée d’une légère brume. Les loups se jetèrent sur leur victime qui les repoussait à coups de crosse, auxquels ils répondaient à coups de dents et de griffes.
Soudain, l’homme se heurta contre une échelle... Où s’appuyait cette échelle ?... Peu importait. S’il parvenait à en gravir les échelons, les fauves ne pourraient s’y hisser après lui, et il serait momentanément en sûreté.
Cette échelle se dressait un peu obliquement au sol, et, circonstance bizarre, son pied ne posait pas à terre, comme si elle eût été suspendue, et le brouillard empêchait de voir où elle prenait son point d’appui supérieur.
Le fugitif en saisit les montants et franchit les échelons inférieurs, au moment où les loups se jetaient une dernière fois sur lui. Des coups de crocs portèrent sur ses bottes, dont le cuir fut déchiré.
Cependant, l’échelle craquait sous le poids de l’homme, elle oscillait sous ses efforts. Allait-elle donc s’abattre ? Cette fois, alors, il serait déchiré, il serait dévoré vivant...
L’échelle résista, et il put en atteindre les derniers échelons avec l’agilité d’un gabier sur les enfléchures des haubans.
Là faisait saillie l’extrémité d’une poutre, une sorte de gros moyeu au bout duquel il était possible de s’achevaler.
L’homme était hors de l’atteinte des loups, qui bondissaient au pied de l’échelle et s’épuisèrent en affreux hurlements.
II. Slave pour slave.
Le fugitif était momentanément en sûreté. Des loups ne peuvent grimper comme l’eussent fait des ours, qui sont non moins nombreux que redoutables dans les forêts livoniennes. Mais il ne fallait pas être contraint de descendre avant que les derniers fauves n’eussent disparu, ce qui arriverait certainement au lever du soleil.
Et, d’abord, pourquoi cette échelle se trouvait-elle disposée en cet endroit, et où s’appuyait son extrémité supérieure ?...
C’était, on l’a dit, au moyeu d’une roue, sur lequel s’implantaient trois autres échelles de même sorte – en réalité, les quatre ailes d’un moulin élevé sur un petit tertre, non loin de l’endroit où l’Embach s’alimente des eaux du lac. Par une heureuse chance, ce moulin ne fonctionnait pas au moment où le fugitif avait pu s’accrocher à l’une de ses ailes.
Restait la possibilité que l’appareil se mît en mouvement dès la pointe du jour, si la brise s’accentuait. Dans ce cas, il eût été difficile de se maintenir sur le moyeu en état de giration. Et, d’ailleurs, le meunier, alors qu’il serait venu décarguer ses toiles et manœuvrer le levier extérieur, eût aperçu cet homme achevalé au croisement des ailes. Mais le fugitif pouvait-il se risquer à descendre ?... Les loups se tenaient toujours là, au pied du tertre, poussant des rugissements qui ne tarderaient pas à donner l’éveil à quelques maisons voisines !...
D’où un seul parti à prendre : s’introduire à l’intérieur du moulin, s’y réfugier pour toute la journée, si le meunier n’y demeurait pas, – supposition assez plausible, – et attendre le soir avant de se remettre en route.
Donc l’homme, se glissant jusqu’au toit, gagna la lucarne à travers laquelle s’engageait le levier de mise en train, dont la tige pendait jusqu’au sol.
Le moulin, ainsi qu’il est habituel dans le pays, se coiffait d’une sorte de carène renversée, ou plutôt d’une sorte de casquette sans visière. Cette toiture roulait sur une série de galets intérieurs, qui permettaient d’orienter l’appareil selon la direction du vent. Il suit de là que la bâtisse principale, en bois, était fixée au sol au lieu de porter sur un pivot central comme la plupart des moulins de la Hollande, et l’on y accédait par deux portes ouvertes à l’opposé l’une de l’autre.
Ayant atteint la lucarne, le fugitif put s’introduire par cette étroite ouverture sans trop de peine ni trop de bruit. À l’intérieur s’évidait une espèce de galetas, traversé horizontalement par l’arbre de couche, lequel se raccordait au moyen d’un engrenage à la tige verticale de la meule, installée dans l’étage inférieur du moulin.
Le silence était aussi profond que l’obscurité. Qu’il n’y eût personne à cette heure au rez-de-chaussée, cela paraissait certain. Un raide escalier, contournant la paroi de madriers, établissait communication avec ce rez-de-chaussée qui avait le sol du tertre pour base. Mais, par prudence, mieux valait ne point se hasarder hors du galetas. Manger d’abord, dormir ensuite, c’étaient là deux besoins impérieux auxquels le fugitif n’aurait pu se soustraire plus longtemps.
Il épuisa donc sa réserve de provisions, ce qui le mettait dans la nécessité de les renouveler pendant sa prochaine étape. Où et comment ?... Il aviserait.
Vers sept heures et demie, la brume s’étant levée, il devenait facile de reconnaître les abords du moulin. Que voyait-on en se penchant hors de la lucarne : à droite, une plaine tout enflaquée par la fonte des neiges, sillonnée d’une interminable route, qui se dessinait vers l’ouest, avec ses troncs d’arbres juxtaposés, car elle traversait un marécage, au-dessus duquel voletaient des bandes d’oiseaux aquatiques. Vers la gauche s’étendait le lac, glacé à sa surface, sauf au point où s’amorçait la rivière d’Embach.
Çà et là se dressaient quelques pins et sapins au feuillage sombre, qui contrastaient avec les érables et les aulnes réduits à l’état de squelettes.
Le fugitif observa d’abord que les loups, dont il n’entendait plus les hurlements depuis une heure, avaient quitté la place.
« Bien, se dit-il, mais les douaniers et les agents de la police sont plus à redouter que ces fauves !... Aux approches du littoral, il sera plus difficile de les dépister... Je tombe de sommeil... Pourtant, avant de m’endormir, il me faut reconnaître comment fuir en cas d’alerte. »
La pluie avait cessé. La température s’était relevée de quelques degrés, le vent ayant halé l’ouest. Or, cette brise, qui soufflait assez vivement, ne déciderait-elle pas le meunier à remettre son moulin au travail ?...
De cette même lucarne, on pouvait aussi apercevoir, à une demi-verste, diverses maisonnettes isolées, aux chaumes blancs par places, et d’où s’échappaient de minces fumées matinales.
Là, sans doute, demeurait le propriétaire du moulin, et il y aurait lieu de surveiller ce hameau.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.