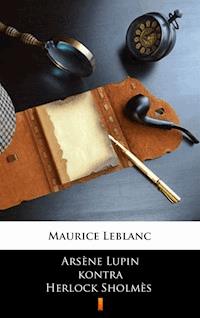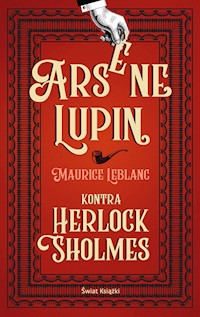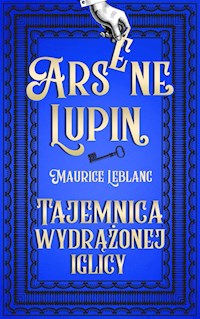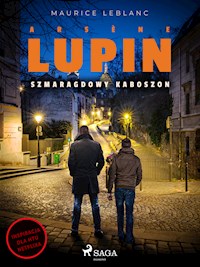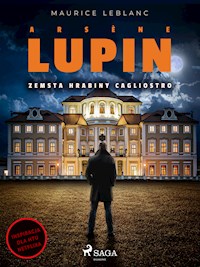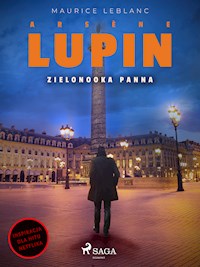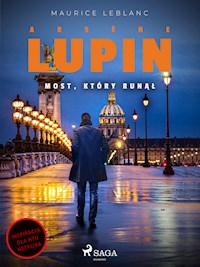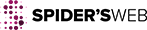14,90 zł
Dowiedz się więcej.
- Wydawca: KtoCzyta.pl
- Kategoria: Kryminał
- Język: polski
Roman policier de Maurice Leblanc, qui n’est pas écrit en style d’histoires d’Arsène Lupin. La fiction nous raconte de le comte Jean d’Orsacq, la comtesse Lucienne et leurs amis, qui sont invités à participer à une semaine de chasse dans un château. L’intrigue s’installe comme un casse-tête. Qui rôde dans le parc? Qui s’est introduit, la nuit, dans les appartements? Qui a ouvert le coffre-fort? Un voleur? Un crime est commis! Quelqu’un est retrouvé assassiné...
Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:
Liczba stron: 231
Podobne
Maurice Leblanc
Le Chapelet rouge
Varsovie 2017
Table des matières
Prologue
Première partie
La Soirée
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Deuxième partie
La Matinée
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Troisième partie
L’Après-midi
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Épilogue
Prologue
Une première énigme se pose.
Après son déjeuner, le comte Jean d’Orsacq déposa un affectueux baiser sur la main que Lucienne, sa femme, lui tendait, et l’avertit qu’il ne rentrerait au château que le lendemain dimanche. Son automobile l’attendait devant le perron. Une heure et demie plus tard, il arrivait dans ses bureaux de Paris, qu’il trouva fermés, comme ils l’étaient chaque samedi.
Tout de suite, il examina les lettres et les documents que son secrétaire, Arnould, avait préparés à son intention. Quelques lignes du secrétaire annonçaient, en outre, que tout marchait bien, et qu’il comptait apporter à d’Orsacq, vers quatre heures, ce que d’Orsacq était venu chercher.
De fait, un moment plus tard, le secrétaire entrait et déposait entre les mains de son patron une large enveloppe.
– Alors, ça y est ? demanda d’Orsacq. L’affaire est réussie ?
– Oui, monsieur.
– Intégralement ?
– Oui, monsieur.
– Tous les titres sont là-dedans ?
– Tous. Je les ai comptés soigneusement. Selon la cote d’hier, cela monte environ à six cent mille francs.
– Parfait, approuva d’Orsacq. Vous avez fort bien conduit cette affaire, et je vous en tiendrai compte. Mais, le silence absolu, n’est ce pas ?
– Le silence absolu.
– Un mot encore. Vous vous rappelez que, à mon dernier passage ici, il y a quinze jours, j’ai eu l’impression qu’on avait ouvert, je ne sais comment, les tiroirs de ce bureau et qu’on avait fouillé dans mes papiers. Votre enquête ne vous a rien révélé à ce propos ?
– Rien, monsieur. Cette pièce est toujours fermée quand vous êtes à la campagne, et en dehors de moi et de la dactylographe, dont je suis sûr, il n’y a que deux employés, et ils n’ont pas la clef de cette pièce.
– Évidemment… Évidemment… J’ai dû me tromper, avoua d’Orsacq. D’ailleurs, rien n’a été pris. Donc…
Resté seul, il ouvrit les tiroirs dont il avait parlé, constata qu’en effet rien n’avait été pris et, glissant sa main jusqu’au fond de l’un d’eux, ramena deux plaques de carton blanc serrées l’une contre l’autre par un élastique. Il ôta l’élastique. Il y avait là une vingtaine de photographies de femmes très belles, les femmes qu’il avait le plus aimées au cours de sa vie aventureuse et dont il avait jusqu’alors conservé fidèlement l’image.
Il s’approcha de la cheminée, remonta le rideau de tôle, alluma son briquet et, avec les vieux papiers accumulés sur la cendre, fit un brasier où il jeta tous les portraits.
Tous les portraits, sauf un. Celui-là, il le contempla longtemps avec une expression passionnée, et murmura « Christiane ! Christiane ! Les autres femmes ne comptent plus maintenant. J’ai jeté au feu tout mon passé. Il n’y a plus que vous, Christiane. »
Il se promena de long en large, puis, s’arrêtant devant la table, il frappa du plat de la main sur le paquet de titres, et dit à haute voix, d’un ton de triomphe et de joie exaltée :
– Je la tiens, maintenant… Je la tiens… Comment m’échapperait-elle ?
Jean d’Orsacq fit quelques courses et alla voir plusieurs personnes. Ses affaires étant terminées plus vite qu’il ne le croyait, il résolut de retourner au château. À neuf heures, il y dînait avec la comtesse d’Orsacq.
Lucienne d’Orsacq était une femme d’environ trente-cinq ans, toujours souffrante, et qui remplaçait la beauté et la grâce, dont elle était dépourvue, par une grande distinction. Elle inspirait à son mari beaucoup de respect, de l’estime pour ses qualités de maîtresse de maison, et de l’admiration pour l’existence loyale qu’elle menait depuis quinze ans qu’ils étaient mariés. Il l’entourait de soins et de prévenances. Jamais il n’aurait consenti à la faire souffrir.
Le soir, ils causèrent un moment. Elle lui dit :
– J’ai reçu les réponses de nos amis Boisgenêt et Vanol. C’est convenu. Ils arriveront une semaine avant l’ouverture de la chasse.
– C’est-à-dire dans quinze jours.
– Exactement. J’attends maintenant la réponse du petit ménage Bresson. Ils sont gais tous deux et mettront de l’animation. Et je pense qu’on pourrait inviter aussi ton ami Debrioux et sa femme.
D’Orsacq tressaillit.
– Bernard et Christiane ? Mais tu sais bien que Debrioux a déjà refusé. C’est un garçon sauvage…
– Oui, mais il adore la chasse, paraît-il, et je téléphonerai à Christiane.
Jean d’Orsacq regarda sa femme. Elle parlait fort simplement. Il était hors de doute qu’elle n’avait pas la moindre arrière-pensée.
Il objecta :
– Ni Bernard ni Christiane Debrioux ne sont bien divertissants.
– Non, Mais il est trop tard pour lancer d’autres invitations et je tiens à ce qu’on soit huit à table et que le château soit au complet, pour la fête que tu veux organiser, huit jours après, dans le parc, avec les gens du village.
– Comme tu voudras, dit-il. Personne plus que toi n’a le sens des réceptions.
Lorsque Lucienne d’Orsacq eut regagné sa chambre, il s’installa, lui, dans la bibliothèque qui lui servait de cabinet de travail. Les banques étant fermées à Paris, il avait apporté la liasse des titres dans une serviette de cuir qu’il n’avait pour ainsi dire pas quittée depuis son arrivée au château.
Ces titres, il les ôta de la serviette et en fit un rouleau qu’il enveloppa d’un morceau de journal et qu’il ficela. Près de lui, dans le mur massif, un placard était creusé où l’on apercevait, par l’embrasure, un énorme et vieux coffre-fort.
Il tira une petite clef de sa poche, puis manœuvra un certain nombre de fois chacun des trois boutons afin de former le chiffre qui commandait la serrure.
La porte fut ouverte. Il déposa le rouleau des titres, referma, et brouilla le chiffre.
Onze heures sonnèrent à l’horloge du château.
II alluma un cigare qu’il fuma lentement, étendu au creux d’un vaste fauteuil. Jamais il ne s’était senti aussi heureux. Bonheur fait de bien-être d’abord. Il était riche, et il savait jouir de sa richesse auprès d’une épouse attentive, dévouée, qui lui avait consacré son existence et qui s’ingéniait à lui épargner tous les soucis de l’existence quotidienne.
Bonheur fait d’espoir aussi. Il aimait cette admirable Christiane Debrioux, comme on n’aime qu’une fois dans sa vie, et, bien qu’il n’eût encore rien obtenu d’elle, il la devinait touchée, obsédée par cet amour fervent, moins forte, plus accessible enfin.
Une heure s’écoula, dans le silence et l’immobilité. Sa rêverie, peu à peu, s’était changée en une somnolence confuse, lorsque, soudain, il fut tourmenté par un léger bruit, qui se renouvela deux fois, trois fois, et qui le contraignit à se réveiller.
Il prêta l’oreille. Cela provenait de la porte à deux battants qui faisait communiquer la bibliothèque avec le grand salon. Il lui sembla qu’on essayait d’ouvrir, tout doucement… Quelqu’un, évidemment, qui ne le savait pas là…
Jean d’Orsacq était d’une bravoure que nul péril ne pouvait troubler. Avec précaution, il éteignit la lumière et se posta. La pièce était obscure, de grands volets de bois bouchant la large, mais unique croisée du fond.
D’une poussée continue, le battant fut entrebâillé et l’ombre plus noire d’une silhouette se profila dans les ténèbres. Le tort du comte d’Orsacq fut de ne pas patienter et d’agir avant que l’homme n’eût franchi le seuil. En réalité, il craignait que Lucienne n’entendît le bruit et ne s’effrayât. Il saisit donc l’individu à la gorge, le fit reculer et le renversa dans le salon.
La lutte fut violente. Lutte silencieuse, acharnée, qui se déroula par terre, presque sur place. Autant par orgueil que par conscience de sa supériorité, d’Orsacq ne voulait pas appeler les domestiques. Pourtant, il se heurtait à une résistance plus grande qu’il ne le croyait.
– Qui es-tu ? grognait-il. Qu’est-ce que tu viens faire ? Parle, et je te lâche. Sinon, tant pis pour toi, si tu reçois un mauvais coup.
Tout son désir eût été d’arracher à l’ennemi quelques secondes de répit et d’allumer l’électricité pour le voir en pleine face. Mais l’autre, sans essayer de prendre l’offensive, se débattait avec une énergie indomptable et une souplesse déconcertante. Il ne cherchait évidemment qu’à échapper à l’étreinte, et à se sauver. D’Orsacq, qui ne s’y trompait pas, augmentait d’autant plus sa pression dans l’espoir d’épuiser l’adversaire et de le mettre hors de combat.
Il n’y parvint pas. Et tout à coup il arriva que l’homme, par une torsion de tout son être, glissa entre ses mains, rampa sur le tapis et parut s’évanouir dans l’ombre.
D’Orsacq se précipita vers un interrupteur, puis s’élança. Il eut juste le temps d’aviser une silhouette qui s’évadait de la salle à manger voisine par le corridor de service.
Il courut. Ce corridor aboutissait à un petit escalier qui descendait au sous-sol. Et, du sous-sol, on pouvait s’enfuir par une porte basse qui donnait dans le jardin. Mais cette porte basse était toujours fermée par un verrou à clef.
Or, il la trouva ouverte.
Dehors, il aperçut, dans la vague clarté que versait un ciel nuageux, la silhouette qui contournait le château. Il la retrouva, sur la droite, au fil d’une allée qui, entre deux pelouses, atteignait une rivière.
D’Orsacq prit un raccourci et gagna un monticule d’où l’on dominait, à un certain endroit, le cours nonchalant de cette rivière. De fait, l’homme bondit à vingt mètres au-dessous de lui. D’Orsacq, qui avait braqué son revolver, tira. Il y eut un cri. Mais si l’ennemi était atteint, la blessure ne devait pas être grave, car il disparut de nouveau.
Et Jean d’Orsacq ne vit plus rien, ne trouva plus rien, n’entendit plus rien.
D’Orsacq avait un caractère à décisions rapides et à réactions très nettes. Abandonnant la poursuite, il revint au château où il se rendit compte que tout était tranquille, que les lumières étaient éteintes à toutes les chambres, et que sa femme dormait.
Alors il se retira chez lui et se coucha.
Le lendemain, ayant interrogé, il sut que l’incident n’avait réveillé personne, et que le bruit de la détonation n’avait pas été perçu.
Il garda donc le silence. À quoi bon parler ?
Il descendit le long de la rivière, jusqu’à une série de grottes creusées sous les monticules, puis jusqu’au mur qui cernait le parc. Vaines recherches. Mais, ayant suivi le mur, il arriva devant une petite grille renforcée de plaques en fer et que clôturait une ouverture cintrée que l’on n’utilisait jamais. L’individu avait-il passé par là, à l’aller comme au départ ? Mais, en ce cas, il eût été nécessaire qu’il eût la clef de cette issue.
Cependant, il y avait des traces de pas dans l’herbe environnante…
Vers onze heures, une nouvelle se répandit dans le château. À cinq cents mètres au-delà du village, on avait trouvé, en travers de la route nationale, le cadavre d’un homme renversé sans aucun doute par une automobile. Or, ce cadavre portait au bras gauche, sous deux mouchoirs qui formaient compresse et qui étaient rouges de sang, une plaie du fond de laquelle on finit par extraire une balle de revolver.
Il était à supposer que l’homme, blessé, perdant son sang en abondance, était tombé en travers de la route où une automobile l’avait écrasé. Mais qui avait tiré cette balle de revolver ?
L’après-midi, rencontrant un des gendarmes, d’Orsacq apprit le nom de la victime. C’était un sieur Agénor Bâton, domicilié à Paris, rue de Grenelle.
D’Orsacq se souvint. Trois ans auparavant, il avait renvoyé de ses bureaux de Paris un sieur Agénor Bâton, employé chez lui comme homme de peine, et qu’il avait surpris un jour en train de fouiller dans ses papiers.
Était-ce Agénor Bâton son visiteur de la veille, qu’il avait poursuivi et blessé ? Fort probablement.
Était-ce Agénor Bâton qui avait de nouveau fouillé dans les tiroirs de ses bureaux de Paris ? Fort probablement.
Mais alors il aurait fallu qu’il eût :
1° la clef même des bureaux de Paris et celle de la pièce particulière de d’Orsacq ?
2° la clef de la petite grille du château et celle de la porte de service par où l’on pénétrait dans le sous-sol ?
En tout, quatre clefs. Était-ce admissible ?
Et, d’autre part, que cherchait-il, à Paris ? Que cherchait-il au château le soir même où d’Orsacq enfermait les titres dans son coffre-fort ?
Toutes ces questions se présentèrent à l’esprit du comte Jean d’Orsacq durant les jours suivants, et pendant l’enquête que l’on fit aux environs. Mais ni la justice ni lui n’aboutirent à la moindre certitude. La justice ne recueillit aucun renseignement sur l’existence, sur la famille, et même sur l’identité du personnage. Était-ce son véritable nom que ce nom d’Agénor Bâton, inscrit sur une feuille de calepin ? On l’admit, parce qu’il habitait, en effet, sous ce nom, une mansarde à l’adresse indiquée. Mais on n’en fut pas très sûr.
Le hasard fit même, comme tout le personnel des d’Orsacq avait été renouvelé, que l’on ne remonta point jusqu’à cet Agénor Bâton que d’Orsacq avait employé jadis dans ses bureaux de Paris.
D’Orsacq n’était pas homme à se tourmenter pour un problème difficile, ni même à s’y intéresser. Ayant résolu de se taire sur des incidents qui ne concernaient que lui et qui ne pouvaient plus avoir de suite, puisque le personnage était mort, il remit au destin le soin de lui fournir les explications nécessaires, quand le jour des explications serait venu.
Pour l’instant, il n’y pensa même plus. L’existence offrait à ce grand amoureux de la vie des sources d’intérêt constamment renouvelées qui ne lui permettaient pas de s’attarder au passé. Christiane allait-elle accepter l’invitation ? Christiane répondrait-elle à son amour ? Voilà ce qui le passionnait.
Ce n’est qu’au moment le plus intense du drame inattendu qui allait atteindre d’Orsacq, à la minute suprême de son existence, que la clarté jaillit dans les ténèbres.
Et à cette minute-là, le drame était si terrifiant que la solution de l’énigme ne pouvait plus influer sur l’inévitable dénouement.
Les événements qui suivent, relatifs au crime et au vol que nous allons raconter, furent si rapides, qu’il ne s’écoula pas vingt heures entre les péripéties initiales et le coup de théâtre qui mit fin brusquement à l’instruction ouverte. Lorsque la nuée des journalistes s’abattit autour du château d’Orsacq, on peut dire que tout était terminé. Ils se heurtèrent à des grilles closes et à des consignes de silence.
À force de recherches patientes, il nous a été possible de reconstituer l’histoire de ces vingt heures avec assez de minutie et de certitude pour que l’on aperçoive tous les faits essentiels, et rien que ces faits ; et pour que l’on entende toutes les paroles qui concoururent à la découverte de la vérité, et rien que ces paroles.
Et ainsi, cette étrange aventure, si nonchalante dans son court, développement judiciaire, mais si ramassée dans le temps et dans l’espace, si chargée de psychologie et si troublante par l’explosion d’instincts ignorés, si logique par l’enchaînement des faits et si bouleversée par les caprices du hasard, est dévoilée ici pour la première fois, en sa simplicité et son horreur.
Ce qu’il y a de plus tragique dans la vie, ce ne sont pas les drames qui naissent de nos seules fautes et de nos seules passions, mais ceux auxquels le destin semble ajouter, inutilement et méchamment, sa part inhumaine d’extravagance, de folie et de fatalité.
Première partie
La Soirée
Chapitre 1
Ce dimanche-là, ainsi que tous les ans à l’ouverture de la chasse, l’après-midi fut plein d’animation et de gaîté au château d’Orsacq.
C’est un très noble château, dont il ne reste, comme preuve de son origine féodale, qu’une vieille tour massive qui forme l’aile droite et à laquelle s’appuie un long bâtiment sans style qui date du XIXe siècle. Mais la cour d’honneur, toute pavée comme au temps des rois, et gardée par de belles statues, est de grande allure, et l’autre façade où donnent toutes les chambres, domine une vaste pelouse qui descend vers l’eau paresseuse d’une rivière.
Le matin, le comte d’Orsacq et ses hôtes allèrent à la chasse.
Dès trois heures, les grilles de la cour furent grandes ouvertes, et la foule des villages voisins se répandit dans le parc et dans le bois situés sur l’autre rive, tandis qu’arrivaient en automobile les châtelains des environs et les invités de Paris, d’où le château n’est distant que de quatre-vingts kilomètres.
Il y eut d’abord, pour les paysans, des jeux sur la pelouse, mâts de cocagne, courses en sac et autres divertissements. Puis courses à la nage et concours de plongeons près de la chute où l’eau est plus profonde. Gustave, le neveu du jardinier, s’y distingua. Mais tout le succès fut remporté par Amélie, la femme de chambre de Mme d’Orsacq, camériste avenante dont les formes parfaitement moulées dans un maillot succinct furent très appréciées. À quatre heures trois quarts, sur l’esplanade de la cour d’honneur, un goûter fut servi qui réunit paysans et gens du monde. À cinq heures et demie – le comte était un organisateur féru d’exactitude – des groupes de jeunes filles et de petites filles, jambes nues et bras nus, exécutèrent des danses rythmiques d’une grâce incomparable.
Une heure plus tard, comme le soleil se couchait derrière les collines, la foule et les invités étaient partis, et la comtesse, toujours assez lasse, se retira dans son appartement.
Jean d’Orsacq, avec la demi-douzaine d’hôtes qui habitaient le château depuis une semaine, resta un moment sur la terrasse qui s’étend sous les fenêtres du premier étage, vers la gauche. Il faisait assez lourd, un de ces temps où la pluie menace dans un ciel bleu. Puis, on rentra s’habiller pour le dîner.
Un large vestibule, dallé de noir et de blanc, conduit à l’escalier principal qui débouche sur le long couloir des chambres. D’Orsacq ne monta pas tout de suite, comme ses invités. Traversant les pièces du rez-de-chaussée, c’est-à-dire la salle à manger et les deux salons, il pénétra dans la salle ronde, aménagée en bibliothèque, qui occupait la vieille tour, et d’où la galerie supérieure, à laquelle on accédait par un escalier de bois sculpté, communiquait avec le boudoir de Mme d’Orsacq.
Il fut assez surpris de trouver, dans cette bibliothèque, le neveu du jardinier, Gustave, qui portait une brassée de grandes fleurs.
– Qu’est-ce que tu fais là ? demanda-t-il.
Gustave, un garçon d’une vingtaine d’années, le regard fuyant, la tête trop grosse, gêné dans son costume du dimanche, mais de bonne mine et les joues fraîches, répondit :
– C’est madame la comtesse qui m’avait dit d’apporter des fleurs pour ici.
– Eh bien, il fallait les remettre à la femme de chambre.
– Amélie est occupée avec Madame et n’a pas voulu que j’entre là-haut… alors…
– Laisse tes fleurs sur cette table.
Gustave obéit.
– C’est toi, reprit d’Orsacq, qui as ouvert le placard ?
Il désignait, à droite, le placard creusé dans le mur et qui contenait le coffre-fort.
– Non, monsieur le comte, affirma Gustave.
Le comte l’observa, puis ordonna :
– C’est bien. Va-t-en.
Le garçon sortit. D’Orsacq poussa le battant, mais, la serrure fonctionnant mal, il disposa un fauteuil de façon que le placard parût fermé.
Ensuite, craignant de déranger sa femme, il repassa par les salons et le vestibule, monta l’escalier principal et gagna son appartement, lequel était contigu à celui de la comtesse d’Orsacq. Vers huit heures, il sortait de son cabinet de toilette, et, après avoir frappé, entrait dans la chambre de sa femme au moment où la cloche du château annonçait le dîner.
– Tu es prête, Lucienne ?
Ce n’est que le premier coup qui sonne, dit-elle en achevant de se coiffer.
Il la regarda dans le miroir et lui dit :
– Tu es en beauté, ce soir.
Ce n’était pas vrai. Lucienne ne pouvait pas être en beauté, ce soir-là plus que les autres, parce qu’elle n’avait jamais l’air aimable, qu’elle portait des lunettes qui grossissaient inégalement ses yeux de myope, et que son visage, trop pâle et maladif, manquait totalement d’expression. Mais Jean d’Orsacq était de ces maris qui, ayant toujours à se faire pardonner, prennent l’habitude de traiter leur femme avec une courtoisie exagérée.
– Tu n’est pas trop fatiguée par la réception de tantôt ? demanda-t-il.
– Je suis toujours fatiguée, dit Lucienne.
– Tu prends tant de drogues !
– Il faut bien… pour me remonter.
– Est-ce pour te remonter que tu avales chaque soir un soporifique ?
– C’est un supplice que l’insomnie ! gémit-elle.
II tourna un moment dans la pièce, cherchant un sujet de conversation, car il ne savait jamais quoi dire à sa femme. Si liés qu’ils fussent par les habitudes, par la communauté de la vie et par une réelle affection, il n’y avait pas entre eux la moindre intimité. Il vivait près d’elle en amitié et en confiance, et se contentait de savoir qu’elle avait pour lui un grand attachement. À la fin, il prononça – comme s’il poursuivait une idée qui l’eût préoccupé :
– Comment mon pauvre père a-t-il pu jadis choisir un emplacement aussi baroque pour y mettre son coffre-fort ?
– Où l’aurais-tu mis, toi ?
– N’importe où, excepté où il est.
– Qu’est-ce que cela peut te faire, puisque tu n’y enfermes que des paperasses sans intérêt ?
– Tout de même…
– Et encore faudrait-il pour l’ouvrir, reprit Lucienne, que l’on connût le mot de la serrure.
– Ça, évidemment, dit-il, tu as raison… Tiens, voilà le second coup qui sonne…
Il s’arrêta :
– À propos, tu avais bien dit à Gustave d’apporter des fleurs coupées ?
– Oui, mais pas de venir frapper à ma porte au moment où je me reposais. J’étais furieuse. Depuis, Amélie a dû les arranger, ces fleurs…
La comtesse, suivie de son mari, traversa son boudoir, ouvrit la porte qui donnait sur la galerie de la bibliothèque et descendit la quinzaine de marches de l’escalier. Leurs invités les attendaient.
La pièce, circulaire et de grandes dimensions, s’ornait de rayons que recouvraient des milliers de livres à belles reliures de cuir fauve. Une seule fenêtre, mais très large, dominait de deux ou trois mètres l’immense pelouse qui s’allongeait jusqu’à la rivière. Il n’y avait également qu’une porte à l’opposé, celle qui livrait passage vers les salons et la salle à manger.
Les deux battants en furent poussés presque aussitôt par le maître d’hôtel. D’Orsacq le prit à part, tandis que sa femme et les invités allaient à table, et lui dit :
– Comment se fait-il, Ravenot, que ce placard soit toujours entrebâillé ?
– C’est de la faute de la serrure, monsieur le comte, le serrurier doit venir demain.
– Vous y veillerez, n’est-ce pas ? En attendant, laissez ce fauteuil tout contre.
Le dîner fut très gai. Autour de la table, outre les châtelains, il y avait deux vieux garçons, Boisgenêt et Vanol, amis intimes, qui ne cessaient de se quereller, Boisgenêt avec esprit et bonne humeur, Vanol avec amertume et colère, et deux ménages, les Debrioux et les Bresson.
Les Debrioux parlaient peu ; lui, Bernard, d’aspect timide, effacé, avec une expression inquiète et tourmentée ; elle, Christiane, très belle, de visage passionné sous ses cheveux blonds ondulés, tour à tour souriante et grave, attentive et distraite, amusée et songeuse, assez énigmatique. En revanche, le jeune couple Bresson semblait ignorer le silence.
C’étaient des boute-en-train, par profession, par goût et par nécessité. Avides de luxe, courant les invitations, ils payaient leur écot à force de rires, de clameurs, d’espiègleries et d’inventions plus ou moins cocasses.
Comme à l’ordinaire, Lucienne d’Orsacq somnolait, absente, n’écoutant rien de ce qui se disait, mangeant à peine, toute aux flacons de pilules et aux boîtes de cachets qui s’amoncelaient devant son assiette, dans un plateau de cristal. Son mari contrastait avec elle par son excès de vie, par son appétit, par sa verve, par son exubérance. Carré d’épaules, le torse puissant dans son smoking de bonne coupe, le visage massif, le front haut et intelligent, il avait une physionomie qui imposait la sympathie. Il parlait beaucoup, de lui, de ses affaires, de ses entreprises financières, des coups de Bourse qu’il avait réussis ou qu’il complotait. Mais il en parlait d’une façon si pittoresque et d’une voix où palpitait tant d’énergie que l’on ne se lassait pas de l’écouter. Il s’adressait surtout aux femmes, à la sienne d’abord avec une déférence affectée, à Léonie Bresson avec un rien d’ironie amicale, à Christiane avec un désir qu’il ne dissimulait pas de capter son attention et de lui plaire.
En tout cas, il intéressait la jeune femme. Ses réparties la faisaient rire, et elle répondait à sa gaîté en sortant parfois d’elle-même, et en s’abandonnant à des minutes d’exubérance où se révélait un esprit vif, curieux de tout et pittoresque.
– L’essentiel, dans la vie, dit-il, c’est de faire des bêtises. J’en ai fait beaucoup, non pas tant par faiblesse ou entraînement que pour me prouver à moi-même que j’étais capable d’en faire, tout en restant d’aplomb sur mes jambes, les épaules effacées et la tête droite. Bernard n’est pas ainsi, n’est-ce pas, mon vieux ?
– Ma foi non.
– Et vous, chère madame ? dit-il en s’adressant à Christiane.
Posément et gaîment, elle répliqua :
– J’ai plutôt la nature de mon mari. J’aime les limites, les garde-fous, les parapets, les espaces tirés au cordeau, l’exactitude et l’égalité. La semaine a sept jours pour moi, et les heures soixante minutes.
– Quel étrange besoin d’étouffer la fantaisie !
– Je ne l’étouffe pas je la surveille. Sans quoi, sait-on jusqu’où elle nous mènerait ?
– Jusqu’au bonheur.
– Le bonheur est dans la règle. Je ne suis jamais aussi heureuse que quand tout est en ordre autour de moi et en moi.
– Le bonheur est dans l’imprévu ! s’écria d’Orsacq. Je ne suis jamais aussi heureux que dans l’excès et le tumulte.
Chacun exposa sa théorie du bonheur. Vanol prônait la santé, Boisgenêt l’argent, et les Bresson, l’agitation.
– Le bonheur, c’est de dormir, dit Lucienne d’Orsacq en se levant, et vous êtes tous des privilégiés, si vous dormez assez, pour le chercher ailleurs.
Léonie Bresson lui rappela que, sur sa demande, on avait projeté d’illuminer la rivière.
– D’accord, dit-elle. Mais laissez-moi prendre un peu de repos. Vous m’excusez, vous tous ?
Elle s’appuya au bras de Boisgenêt qui l’accompagna jusque dans la bibliothèque. Et elle lui dit, en montant l’escalier intérieur pour se rendre dans son boudoir et dans sa chambre :
– Qu’on ne me dérange pas, cher ami, au cas où je dormirais. Je suis assez lasse.
– Mais vous venez avec nous ?
– C’est bien mon intention. Mais surtout qu’on ne s’occupe pas de moi.
Boisgenêt resta seul un moment. C’était un monsieur d’une soixantaine d’années, vert encore, et qui cambrait une taille bien prise. Peu de cheveux, mais tous ramenés et ratissés avec un soin minutieux. Tout en sifflotant une scie de café-concert, il jeta un coup d’œil autour de lui, poussa le fauteuil qui maintenait le battant du placard, passa la tête par l’entrebâillement, et referma après avoir aperçu et examiné le coffre-fort à la clarté des lumières qui venaient de la pièce.
Puis, il prit sur la table un paquet de cigarettes à bout d’or, qu’il vida aux trois quarts dans sa poche. Enfin, il alla vers un guéridon ancien, ouvrit un tiroir, et saisit une boîte de superbes havanes dont il choisit et escamota une bonne moitié.
– Monsieur désire un cigare ? dit la femme de chambre qui apportait le plateau des liqueurs.
– Amélie, je n’ai besoin de personne pour faire ma provision de cigares. Ce n’est pas que je fume. Mais il est toujours commode de pouvoir offrir un cigare de luxe à ses amis.
La femme de chambre proposa des liqueurs à Boisgenêt qui répondit :
– Le café d’abord, Amélie.
– Le maître d’hôtel l’apporte tout de suite, monsieur.
– Alors, versez-moi un peu de fine champagne.
Tandis qu’elle versait, il la regardait avec complaisance. Si simple que fût sa robe, elle prenait sur elle un air d’élégance et de raffinement qui lui donnait l’aspect d’une invitée. Son jeune visage plaisait par son ingénuité et sa coquetterie naturelle.
– Je vous ai vue tantôt sortir de l’eau, Amélie. Fichtre !
– Monsieur dit ?
– Je dis fichtre ! Ce qui signifie, en l’occurrence, que vous êtes rudement bien balancée ! Vous avez dû remarquer d’ailleurs, Amélie, depuis le premier jour, que je vous trouvais à mon goût…
– Monsieur plaisante…
– Je ne demande, en effet, qu’à plaisanter, Amélie. Pourquoi n’est-ce pas vous qui apportez mon chocolat, le matin ?
– C’est le rôle du maître d’hôtel, monsieur.
– J’ai horreur de cet individu. Il y a longtemps qu’il est au château ?
– Quinze jours, comme moi. Nous sommes arrivés la semaine d’avant Monsieur.
– Eh bien, il a la figure qui ne me revient pas. Tandis que la vôtre est charmante, Amélie. Et puis, vous sentez rudement bon…
– Quelle chance dit-elle en riant.
– Un parfum dont je raffole… « Le clair de lune sous la roseraie en fleurs après un jour de pluie »… C’est un peu long mais capiteux.
– Le parfum de Madame.
– Je m’en doute. Et comme je ne peux pas embrasser Madame…
D’un geste vif, il embrassa dans le cou Amélie, qui ne chercha pas trop à se dérober. Malheureusement, le maître d’hôtel entrait à la seconde précise, les mains chargées du plateau de café.
– Cré bon sang ! s’écria-t-il.
Boisgenêt se mit à rire.
– Pas de veine ! Je chipe des cigares, la bonne survient.
J’embrasse la bonne, le domestique surgit.
– Eh bien, vous en avez du culot, vous ! proféra le maître d’hôtel qui, s’étant débarrassé du plateau, se planta devant Boisgenêt. Qui est ce qui vous a permis d’embrasser Amélie ?
– C’est votre bonne amie ?
– C’est ma femme.
– Crebleu ! mais il fallait me prévenir ! dit Boisgenêt avec calme. Et moi qui voulais vous demander de vous entendre avec elle pour qu’elle m’apporte mon chocolat du matin dans mon lit.
Ravenot était hors de lui. Il grinça, les poings serrés :
– Je vous retrouverai, vous. Si jamais vous me tombez sous la patte ! D’abord c’est vous, sans doute, qui avez dérangé ce fauteuil, n’est-ce pas ?
– Et c’est lui qui barbote les cigares…, plaisanta la femme de chambre.
– Toi, grogna Ravenot, si je te repince à tourner autour de ce vieux-là !…
Une bouffée de musique pénétra dans la pièce avec Vanol qui grogna d’un air exaspéré :
– Zut ! Le phonographe maintenant !
Ravenot s’en allait. En passant, il bouscula Boisgenêt, mâchonna une injure, prit sa femme par le bras, et sortit.
– Quelle brute ! ricana Boisgenêt. Il est furieux parce que j’ai embrassé sa femme.
Vanol se moqua.
– Tu embrasses donc les femmes de chambre ?
– À l’occasion, et devant les maris.
– Celui-là aurait dû te remercier.
– C’est un goujat.
– Ravenot ? Il me plaît beaucoup.
– Évidemment, dit Boisgenêt.
– Pourquoi, évidemment ?
– Parce qu’il me déplaît. Tu ne penses et tu ne juges que par opposition avec moi. Un cigare ?
– Avec plaisir.
– Évidemment. Tu fumes parce que je ne fume pas. Tu ne fumerais pas si je fumais.
– Alors, pourquoi m’offres-tu ce cigare ?
– Pour te montrer ton esprit d’opposition. Je suis ruiné, tu es riche. Je ne fiche rien, tu travailles. Je vois la vie en rose poupon, toi en noir corbillard. Je suis bien habillé, tu es vêtu comme un laissé-pour-compte. Bref, toujours le contre-pied de ce que je fais.
– Qu’est-ce que tu as ce soir ?
– Comme toujours, de bonne humeur.
– Pas comme moi. Tous ces gens-là m’embêtent.
– Moi, je les trouve charmants.
– D’Orsacq, charmant ? Un homme à femmes, sans scrupules !
– Qu’est-ce que ça peut te faire ? La tienne t’a quitté.
– Un spéculateur ! Un gentilhomme qui fait des affaires Et quelles affaires ! Bigre, je ne voudrais pas être entre ses griffes. Heureusement que j’ai du flair !
– Tu as de la bile surtout. Voyons, quoi, c’est joyeux ici. Les invités sont aimables.
– Le ménage Debrioux ? Parlons-en ! Elle, Christiane, une tragique ! Lui, Bernard, un sombre, un malchanceux acculé à la faillite.
– Qu’en sais-tu ?
– Des bruits qui courent.
– Et le couple Bresson ? Voilà de la gaîté…
– Oui ! Oui ! des gens qui voyagent avec un phonographe, une valise de T.S.F., un accordéon et des feux de Bengale. Tous les talents de société. Petits jeux, lignes de la main, tables tournantes. Rien de plus horripilant. Tiens, les voici. Veux-tu parier que Bresson va nous proposer un tour de cartes ou une charade ?
Ce fut une entrée de music-hall qu’effectua le jeune ménage, tous deux, castagnettes aux poings et buste renversé. Et ils tourbillonnèrent un instant dans la pièce tandis que Jean d’Orsacq les accompagnait en frappant du pied. Boisgenêt protesta.
– Vous allez réveiller la maîtresse de maison. Elle a recommandé qu’on la laissât dormir.
– Ma femme ? dit le comte, quand elle est sous l’action de ses drogues, rien ne la réveille.
Mais Vanol n’en pouvait plus.
– Non, non, cria-t-il, assez de bruit. Passez à un autre exercice.
Les Bresson n’étaient pas entêtés. Le mari déploya un jeu de cartes sous le nez de Vanol.
– Prenez une carte au hasard.
– Qu’est-ce que je vous avais annoncé ? dit Vanol à Boisgenêt… Le coup de la carte forcée…
Bresson posa le jeu sur une table et s’éloigna.
– Pas forcée du tout. Prenez-en une.
– Zut !
– Ce qu’il est poli !
– Ça m’embête.
– Qu’est-ce qui vous amuse ?
– De ne pas m’amuser.
Et Vanol ajouta soudain, en s’apercevant que Léonie Bresson s’était emparée de sa tasse vide et qu’elle en examinait le fond :
– Ah ! non, pas de ça, je vous en prie !
– C’est vous qui avez bu là-dedans, monsieur Vanol ?
– C’est moi !
– Et vous ne voulez pas que je vous dise ?…
– Le coup du marc de café ? Ah ! jamais de la vie. Il y a trois ans déjà, vous m’avez annoncé que ma femme me lâcherait.
– Mais au fait, je vous l’avais prédit. Avouez que c’est drôle…
– Pas pour moi.
La jeune femme se tourna vers le comte d’Orsacq.
– Et vous, cher monsieur… je peux me permettre ?
Il lui tendit sa tasse.
– Tout ce que vous voudrez, chère amie, mais à une condition…
– Laquelle ?
– Vous direz la vérité.
– Vous n’avez pas peur ?
– De rien.
Elle examina la tasse un instant, et garda le silence. Son mari intervint, subitement inquiet.
– Je t’en prie, Léonie, ne dis pas de bêtises.
– Laissez-la donc, objecta d’Orsacq.
– Mais non, mais non… vous ne la connaissez pas… regardez ses joues qui se creusent, ses yeux qui brillent. Elle est capable, dans ces moments-là, de vous prédire des choses extravagantes.
– Des choses qui arrivent ?
Bresson hésita et laissa tomber sourdement :
– Oui… Elle a le sens de l’avenir. Elle voit clair… Certains de ses pressentiments se sont réalisés et, je l’affirme, dans des conditions vraiment troublantes.
Boisgenêt s’écria en battant des mains :
– Bravo, le ménage Bresson ! la scène est supérieurement jouée. Tandis que l’épouse ausculte le marc de café, l’époux se charge du trémolo, et nous fait dresser les cheveux sur la tête… Allez-y ! ma petite Léonie ! Un accident rigolo, hein ? Vanol se casse la jambe…
La jeune femme se taisait, livide, la figure contractée. Le comte insista :
– Eh bien ! qu’y a-t-il donc, chère amie ? Vous avez l’air tout émue.
– Émue, non, prononça-t-elle sans quitter des yeux le fond de la tasse. Mais je ne sais si je dois…
– Mais oui, mais oui… Il s’agit sans doute de pertes d’argent, n’est-ce pas ! Et cela me concerne ?
– Non… non… murmura-t-elle… cela ne vous concerne pas spécialement… il s’agit d’une chose qui se passe ici… ou qui va se passer… qui nous menace tous… un drame…
– Ah ! non, hurla Vanol qui était blême, pas de drame !
– Mais c’est passionnant, au contraire, plaisanta Jean d’Orsacq. La vie serait monotone sans les drames… Et celui-là a lieu ici ?
– Oui.
– L’année prochaine ?
– Ce soir.
– Au bout du parc ?
– Dans ce château.
– Au grenier ?
– À cet étage.
– À cet étage ? Et quelle sorte de drame ? On cambriole ?
– Oui… il y a cela… un voleur… et puis…
– Et puis quoi ?
– Ah ! c’est effrayant… mais sûrement, sûrement… il y a crime…
– À merveille ! s’exclama le comte, qui riait franchement. Un crime ! Mais c’est admirable… Et comment ? Par le poison… Le fusil ?
Elle dit, de plus en plus bas :
– Le poignard… Voyez, ici, sur la droite, cette petite croix… Et puis… et puis… mais oui, regardez cette teinte rougeâtre… Oui…, il y a du sang.
Vanol tomba sur un fauteuil. Christiane Debrioux et son mari souriaient, Boisgenêt perdait son assurance. À ce moment, tous, ils se dressèrent. Un cri avait jailli, aigre, strident, affreux… un cri qui venait d’au-delà des salons, du côté de la salle à manger.
Ils écoutèrent. Rien. Aucun bruit.
– Qu’est-ce qui se passe ? murmura le comte d’Orsacq.
Justement Ravenot apparaissait dans le grand salon, un plateau vide en mains, et l’air tranquille.
– Qu’est-ce qu’il y a, Ravenot ?
– Monsieur le comte désire ?…
– Comment mais nous n’avez pas entendu ? On a crié ?
Ravenot demeurait ébahi et répétait :
– On a crié ? Mais non, monsieur le comte. Si l’on avait crié par ici, j’aurais entendu… J’étais dans l’office avec Amélie…
D’Orsacq et Boisgenêt voulurent se rendre compte. Ils ne virent rien de suspect. Est-ce que réellement on avait entendu un cri ?
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.
C’est un échantillon gratuit. S'il vous plaît acheter la version complète du livre pour continuer.